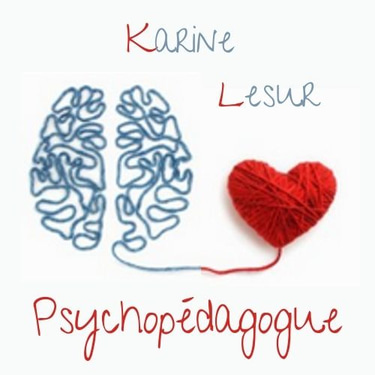Neurosciences à l'école : entre neuroenthousiasme et neuroscepticisme
Les neurosciences à l'école : adhérer ou se méfier?
GÉNÉRALITÉS
Karine Lesur, Psychopédagogue
3/3/20252 min read
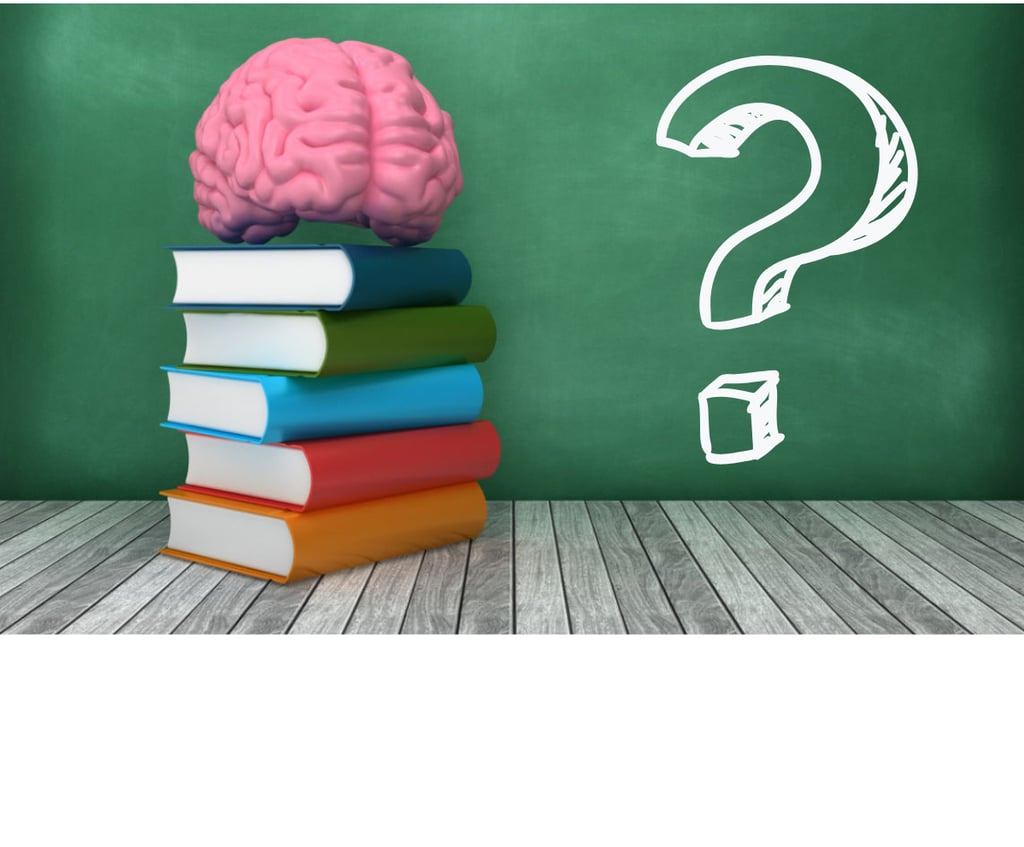
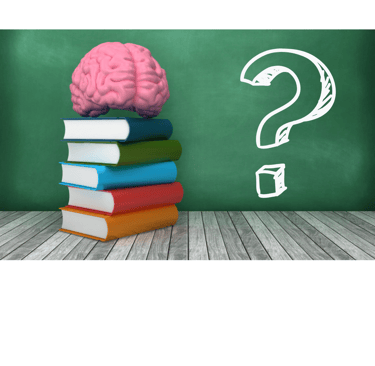
Neurosciences à l’école : entre neuroenthousiasme et neuroscepticisme
Depuis quelques années, les neurosciences s’invitent dans les salles de classe. Mieux comprendre le fonctionnement du cerveau permettrait d’améliorer les apprentissages et d’adapter les pratiques pédagogiques. Mais l'avis des enseignants est partagé, entre enthousiasme et scepticisme.
🔥 Le neuroenthousiasme : un vent d’espoir pour l’éducation
Les avancées en neurosciences ont permis de mettre en lumière certains mécanismes clés de l’apprentissage :
📌 L’attention comme porte d’entrée de l’apprentissage
📌La consolidation mnésique : effet d'espacement et effet testing
📌L'importance des fonctions exécutives, avec les 2 systèmes de pensées, heuristique et algorithmique
📌 L’importance des émotions dans l’apprentissage
Les neurosciences offrent ainsi un cadre pour optimiser les méthodes pédagogiques et invitent à abandonner certaines pratiques peu efficaces.
❄️ Le neuroscepticisme : une prudence nécessaire
À l’inverse, certains soulignent :
⚠️ Le risque des "neuromythes", véhiculant des interprétations simplistes et erronées de la recherche scientifique
⚠️ Des résultats difficiles à transposer en classe, les conditions du laboratoire étant très éloignées de la réalité scolaire
⚠️ Un discours parfois trop injonctif, avec des recommandations pédagogiques uniquement issues de la recherche et éloignées des conditions réelles d'enseignement.
🎯 Vers un équilibre entre neuroscience et pédagogie
Les neurosciences ne sont pas une baguette magique pour transformer l’école, mais elles offrent des pistes précieuses d'amélioration. L’enjeu est d’adopter une approche éclairée, fondée sur des données probantes et une expérimentation réfléchie qui prend en compte la réalité de la classe.
De plus, si les neurosciences ne peuvent à elles seules dicter des pratiques pédagogiques (les enseignants n'étant alors plus que de simples exécutants), les recommandations pédagogiques ne peuvent pas non plus être uniquement issues de la pratique (même si les enseignants ont souvent une connaissance intuitive des processus d'apprentissage, il est nécessaire de se fier à des preuves scientifiques).
Au laboratoire de La Psydé, Gregoire Borst directeur du laboratoire et Arnaud Cachia, responsable du DU de Neuroéducation, tous deux professeurs de sciences cognitives, affichent une réelle volonté d'associer les données des neurosciences à celles des autres disciplines des sciences de l'éducation, et sont bien loin de l'impérialisme disciplinaire de certains autres neuroscientifiques.
Ils souhaitent croiser les expertises respectives des enseignants (en pédagogie) et des scientifiques (en recherche expérimentale), et impulser une véritable dynamique entre le labo et la classe grâce aux recherches collaboratives menées par Marie Létang en partenariat avec Léa.fr.
J'ai adoré faire le DU de Neuroéducation avec eux!